
Hervé Guibert en quatre œuvres majeures
À l’occasion de la réédition du roman autobiographique La Mort propagande et du film La Pudeur et l’impudeur, retrouvons Hervé Guibert à travers quatre œuvres marquantes, parmi tant d’autres.
Hervé Guibert est passé comme un météore. Trop brillant, trop beau, trop sensible. En trente-six ans, il a livré plus d’une douzaine de livres, des centaines d’articles et de photographies. Critique au Monde, auteur pour le théâtre et le cinéma, provocateur-né, étoile mondaine, il aura endossé de nombreux rôles, jusqu’à celui de réalisateur, comme le rappelle aujourd’hui l’édition de son unique film, La Pudeur et l’impudeur.
S’intéresser à Hervé Guibert, c’est aussi se plonger dans une époque, où l’on croise Foucault (son voisin), Isabelle Adjani (sa grande amie), Roland Barthes (qui lui proposa une préface en échange de ses faveurs). Une époque dont on sent bien qu’elle est la fin de quelque chose et le sida n’y est pas pour rien. Le sida traverse l’œuvre de Guibert, avant même qu’il ne soit malade. Il nourrit lui-même, sur la fin de sa vie, l’ambition de «ne plus prononcer le mot sida dans ses livres». Mais même quand il ne le prononce pas, dans un bref récit comme Mon valet et moi par exemple, les thèmes de la perte des moyens, du flétrissement et de la mort sont toujours très présents.
La Mort propagande (éditions Gallimard, 1977)
 «Qui voudra bien produire mon suicide, ce best-seller ?». Cette phrase du premier texte de La Mort propagande, bouleversante, sonne comme une prémonition sous la plume du jeune Hervé Guibert, qui a tout juste vingt-et-un ans. L’auteur le remarque lui-même dans un entretien avec Didier Eribon au moment d’une réédition du livre, en 1991, l’année de sa mort. Une prémonition autant qu’un programme, dans lequel les thèmes des futurs livres de Guibert sont tous là : la chair, la photographie, une espèce de lyrisme scatologique partagé par Michel Tournier ou Olivier Py. Sur cet aspect prémonitoire, Guibert triche sans doute un peu car à la réédition de 1991, il a revu et corrigé les textes du recueil et en a même ajouté certains. Il n’en reste pas moins que l’ensemble est d’une richesse inouïe, notamment en termes de références, révélées ou non.
«Qui voudra bien produire mon suicide, ce best-seller ?». Cette phrase du premier texte de La Mort propagande, bouleversante, sonne comme une prémonition sous la plume du jeune Hervé Guibert, qui a tout juste vingt-et-un ans. L’auteur le remarque lui-même dans un entretien avec Didier Eribon au moment d’une réédition du livre, en 1991, l’année de sa mort. Une prémonition autant qu’un programme, dans lequel les thèmes des futurs livres de Guibert sont tous là : la chair, la photographie, une espèce de lyrisme scatologique partagé par Michel Tournier ou Olivier Py. Sur cet aspect prémonitoire, Guibert triche sans doute un peu car à la réédition de 1991, il a revu et corrigé les textes du recueil et en a même ajouté certains. Il n’en reste pas moins que l’ensemble est d’une richesse inouïe, notamment en termes de références, révélées ou non.
Dans un texte intitulé L’Œillade, ce sont ses maîtres en littérature, Genet et Bataille, qui sont présents alors que dans Petit Journal amoureux, l’écriture est orgie puis massacre, virant de Villon à Pasolini. On ne peut s’empêcher d’imaginer que Guibert a lu Deleuze (qu’il rencontrera à deux reprises) tant ses textes interrogent l’idée de flux. Plus que l’urgence, que l’on commente régulièrement chez les auteurs du sida, c’est l’impossibilité de faire cesser le flux qui est ici obsessionnelle, flux des humeurs, du désir, de la parole. Les textes de cette édition de La Mort propagande s’enchaînent en une logorrhée, qui vire parfois à la diarrhée. Cela peut écœurer, mais on est forcément emporté par ce flot lyrique et incontrôlé.
À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie (éditions Gallimard, 1990)
 À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie est sans doute le roman le plus lu d’Hervé Guibert. C’est aussi le préféré de son amie Isabelle Adjani. On la croise d’ailleurs, ainsi que Michel Foucault, respectivement sous les noms de Marine et Muzil. Car Guibert est considéré comme le premier des écrivains de l’autofiction, avant Guillaume Dustan et Christine Angot. Dans À l’ami, il fait non seulement le récit de la lente dégradation de son corps, mais aussi de l’influence de la maladie sur sa propre psychologie et sur les rapports qu’il entretient avec ses amants et amis. Le sida s’insinue comme un personnage malveillant dans des jeux relationnels sans doute déjà passionnels et complexes.
À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie est sans doute le roman le plus lu d’Hervé Guibert. C’est aussi le préféré de son amie Isabelle Adjani. On la croise d’ailleurs, ainsi que Michel Foucault, respectivement sous les noms de Marine et Muzil. Car Guibert est considéré comme le premier des écrivains de l’autofiction, avant Guillaume Dustan et Christine Angot. Dans À l’ami, il fait non seulement le récit de la lente dégradation de son corps, mais aussi de l’influence de la maladie sur sa propre psychologie et sur les rapports qu’il entretient avec ses amants et amis. Le sida s’insinue comme un personnage malveillant dans des jeux relationnels sans doute déjà passionnels et complexes.
Beaucoup reprochent au livre d’être impudique, ou complaisant. Mais livrer un récit d’une telle force sur soi-même révèle autant d’humilité que de narcissisme. On ressent aussi une intelligence un peu méchante, qui ne rate rien, chez l’auteur. Quoi de plus normal alors qu’il y entreprenne un «jeu d’échecs» avec Thomas Bernhard. Ce passage est l’un des plus beaux du livre où littérature et maladie, citation et douleur se mélangent en une phrase interminable «métastasée» par le dramaturge autrichien.
Mon valet et moi (éditions du Seuil, 1991)
 Cet Hervé Guibert joueur et méchant, sûr de lui et manipulateur, mais toujours plein de grâce, on le devine très bien dans le court récit intitulé Mon valet et moi. On pourrait le considérer comme anecdotique, mais quel contrepoint brillant à ses œuvres plus autobiographiques ! Guibert y met en scène un riche vieillard (le narrateur) et son valet tyrannique, dans un jeu de pouvoir tantôt tendre tantôt malsain. Rapports de classes ? Sado-masochisme ? Amour impossible ? Toutes les hypothèses sont permises pour décrire ce tango loufoque entre deux personnages qui sont tour à tour chasseur et proie.
Cet Hervé Guibert joueur et méchant, sûr de lui et manipulateur, mais toujours plein de grâce, on le devine très bien dans le court récit intitulé Mon valet et moi. On pourrait le considérer comme anecdotique, mais quel contrepoint brillant à ses œuvres plus autobiographiques ! Guibert y met en scène un riche vieillard (le narrateur) et son valet tyrannique, dans un jeu de pouvoir tantôt tendre tantôt malsain. Rapports de classes ? Sado-masochisme ? Amour impossible ? Toutes les hypothèses sont permises pour décrire ce tango loufoque entre deux personnages qui sont tour à tour chasseur et proie.
La Pudeur et l’impudeur (BQHL éditions, 1990-1991)
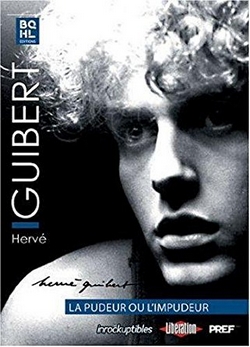 On comprend mieux l’acharnement que Guibert met à disséquer vivant le vieillard de Mon valet et moi lorsque l’on visionne, ahuri, le seul film qu’il aura réalisé (mais qu’il n’aura jamais vu monté) : La Pudeur et l’impudeur. Première image, Hervé Guibert est dans son fauteuil, au téléphone. Une voix grave, aussi prétentieuse que séductrice, qui commente son suivi médical comme il l’a fait dans ses livres : «ils ont perdu la prise de sang que j’ai faite il y a quinze jours, bravo !».
On comprend mieux l’acharnement que Guibert met à disséquer vivant le vieillard de Mon valet et moi lorsque l’on visionne, ahuri, le seul film qu’il aura réalisé (mais qu’il n’aura jamais vu monté) : La Pudeur et l’impudeur. Première image, Hervé Guibert est dans son fauteuil, au téléphone. Une voix grave, aussi prétentieuse que séductrice, qui commente son suivi médical comme il l’a fait dans ses livres : «ils ont perdu la prise de sang que j’ai faite il y a quinze jours, bravo !».
Puis, il se découvre, on le découvre, affaibli, maigre, rongé par la maladie. Et ce sera le fil rouge du film : Hervé Guibert, 35 ans et son corps de vieillard. À la merci de l’infirmière qui le pique, du kinésithérapeute qui le manipule, des chirurgiens qui le découpent. Si c’est son quotidien que nous montre Guibert, il le met en scène de façon très cadrée ; de longs plans fixes imaginés comme des photographies. Des photographies de son appartement parisien, du presbytère de Santa Catarina sur l’île d’Elbe où il aimait se reposer. Il se met en scène faisant des exercices, sur le trône, dans la baignoire.
Cette obstination à montrer ce corps qui disparaît est bouleversante. Plus encore quand il fait résonner son histoire avec la vieillesse de ses deux tantes, Louise et Suzanne, personnages récurrents de son œuvre. Il demande à cette dernière, impotente, avec une voix d’enfant : «est-ce que tu penses qu’il faut se suicider quand on a très mal ?». La réponse fuse, c’est non. La réflexion sur le suicide est centrale dans toute la deuxième moitié du film, avec pour point d’orgue une scène dans laquelle il imagine un dispositif de roulette russe : deux verres d’eau dont un dans lequel il a versé soixante-dix gouttes de digitaline, la dose mortelle. Il les fait tourner les yeux fermés et en boit un. Bien sûr, il s’agit d’un canular. À ce moment là, le cinéma s’assume, on s’éloigne du document, à moins que ce moment factice soit le plus proche de l’auteur à ce moment-là.
Le film est complété par l’émission d’Apostrophe dans laquelle il était venu mi-crânement, mi-sagement raconter sa maladie, par un entretien donné à Patrick Poivre d’Arvor dans l’émission Ex-Libris et enfin par un diaporama de photos prises par Hervé Guibert.
La Compagnie des auteurs de Matthieu Garrigou-Lagrange consacrée à Hervé Guibert, 4 épisodes disponibles en podcast sur France Culture.
Photo de Une © Jacques Robert
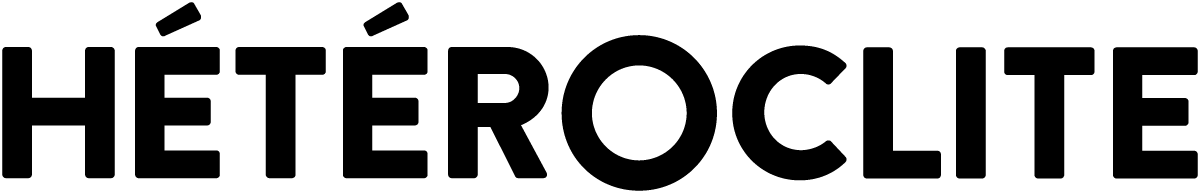
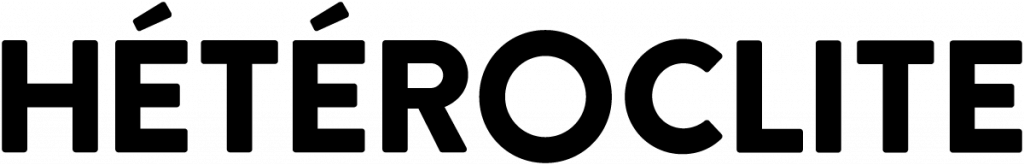



Pingback: Ce qu'aimer veut dire de Mathieu Lindon - Heteroclite