
Robin Campillo, le sida, Act Up et nous
Après Les Revenants (2004) et Eastern Boys (2013), Robin Campillo réalise avec 120 battements par minute une fresque magistrale sur le militantisme et l’amour au temps du sida, justement récompensée par la Queer Palm et le Grand Prix du Jury au dernier Festival de Cannes. Rencontre avec un cinéaste qui a lui-même été, au début des années 90, un militant très actif d’Act Up, l’association qu’il met en scène dans le film.
Certains «anciens» d’Act Up (dont son cofondateur, Didier Lestrade) ont pointé le décalage entre l’accueil critique très enthousiaste qu’a reçu 120 battements par minute et l’hostilité, voire la haine, que suscitait l’association auprès des grands médias à l’époque où se déroule le récit. Comment l’expliquez-vous ? Est-ce qu’Act Up serait devenue consensuelle ?
Robin Campillo : Je crois que beaucoup essayent de se racheter une bonne conduite. Valérie Pécresse, la présidente Les Républicains du conseil régional d’Île-de-France, s’est par exemple fendu d’un tweet pour saluer «un film audacieux soutenu par la région». En réalité, obtenir un financement de la région a été très compliqué, notamment parce que le comité décisionnel était composé pour partie d’élus de la majorité de droite qui y étaient farouchement opposés… Et encore, on n’a reçu l’argent qu’à la toute fin du tournage !
Donc je ne veux absolument pas que Pécresse se serve de mon film pour faire oublier qu’elle a coupé les financements régionaux aux études sur le genre ou à certaines associations LGBT. J’ai l’impression que, maintenant que les militant-e-s de La Manif Pour Tous ont abandonné Les Républicains pour le Front national et qu’elle doit se trouver une nouvelle base électorale, elle essaye, avec un opportunisme assez incroyable, de se donner une image friendly.
Mais elle n’est pas la seule. Tout le monde cherche à récupérer le succès du film. On a reçu plusieurs invitations de l’Élysée qu’on a toutes refusées, les unes après les autres. On avait déjà vécu ça avec Entre les murs [Palme d’Or 2008, réalisée par Laurent Cantet et scénarisée par Robin Campillo, NdlR]. À l’époque, Sarkozy voulait absolument recevoir tous les gamins du film à l’Élysée alors que le film était précisément dirigé contre lui et ses politiques éducatives… Les gens de pouvoir détestent qu’on leur dise «non». Ça les vexe d’une façon incroyable !
Maintenant, c’est vrai que le regard du public et des médias sur le militantisme contre le sida n’est plus le même et on ne peut pas le regretter. Cela montre que la réflexion des gens sur l’épidémie a évolué et c’est tant mieux. Mais on n’a pas encore changé de paradigme et on manque toujours de campagnes de prévention dignes de ce nom, donc on ne peut pas dire que cette lutte soit devenue consensuelle. Le film parle d’une époque où un groupe minoritaire pouvait encore avoir un impact et, dans ces temps d’impuissance politique, je pense que c’est cela aussi qui a séduit beaucoup de monde.
On sent depuis quelques années un regain d’intérêt pour les premiers temps de l’épidémie de sida, avec des documentaires comme We Were Here, un roman comme N’essuie jamais de larmes sans gant (adapté en série télévisée sous le nom de Snö), des films comme San Francisco 1985 et, tout récemment, votre film, le livre de Didier Roth-Bettoni sur Les Années sida à l’écran ou celui d’Elisabeth Lebovici, Ce que le sida m’a fait. Face à cela, certains mettent en garde contre le risque de tomber dans une sorte de «nostalgie» qui occulterait la réalité de la maladie en 2017. Qu’en pensez-vous ?
Robin Campillo : Je ne pense pas que les personnes qui ont connu cette époque puissent en être «nostalgiques» de quelque façon que ce soit. C’était beaucoup trop dur, trop violent, trop brutal. Personne ne peut regretter ce temps-là. En revanche, je crois que les gens de ma génération ressentent le besoin et le devoir de se remémorer cette période, de raconter comment cela s’est passé. C’est impossible pour nous de ne pas en parler. Redonner la parole aux acteurs de ce combat, c’est une façon de reprendre la main sur le sida, sur notre histoire mais aussi notre avenir. C’est vital. Je pense par exemple à un ancien militant d’Act Up New York qui a récemment arrêté de prendre son traitement et s’est laissé mourir parce qu’il avait le sentiment que cette lutte avait été oubliée.
Beaucoup de personnes impliquées dans ce combat, que ce soit aux États-Unis ou en France, n’ont pas obtenu la reconnaissance qu’elles méritent. C’est le cas de Didier Lestrade, par exemple, qui a fondé ou cofondé non seulement Act Up Paris, mais aussi des journaux comme Têtu ou, avant cela, Magazine (1980-1987).
Est-ce à dire que la vraie question, c’est plutôt de savoir ce que l’on fait de cette mémoire-là une fois qu’on l’a ravivée ?
Robin Campillo : Ce qui me semble intéressant, c’est de mettre en regard le passé et le présent. De voir par exemple comment les moyens de prévention ont évolué. Il n’y a plus seulement le préservatif : il existe aujourd’hui d’autres outils qu’on n’aurait jamais pu imaginer à l’époque. La PrEP, par exemple, c’est quelque chose qu’on peut bien sûr critiquer, mais certains prennent des risques et ont besoin de ce traitement préventif pour être protégés. On sait aujourd’hui qu’une personne séropositive sous traitement n’est plus contaminante et c’est une très bonne nouvelle qui laisse l’espoir d’arriver à juguler l’épidémie, comme à San Francisco. Pour cela, on a besoin de campagnes de prévention et de dépistage extrêmement fortes. Mais il y a toujours ce manque de volonté politique, notamment des pouvoirs publics, face au sida. On entend parler de «Paris sans sida» mais, honnêtement, il ne se passe pas grand-chose…
En 2009, bien après avoir quitté Act Up, Didier Lestrade estimait que le mouvement qu’il a contribué à créer était mort, qu’il était devenu au mieux inefficace, au pire contre-productif, en empêchant d’autres initiatives plus pertinentes de voir le jour. Est-ce une analyse que vous partagez ?
Robin Campillo : En tant que séronégatif, ce n’est pas à moi de dire aux séropositifs ce qu’il faut faire, de proclamer qu’Act Up est désormais inutile et doit fermer les portes. Cette association, c’est un peu le bébé de Didier Lestrade et je peux comprendre ce qu’il veut dire, mais je ne crois pas qu’elle empêche d’autres projets d’émerger. J’ai vu des personnes, notamment séropositives, qui avaient quitté Act Up et qui y sont revenus, parce que c’est le seul endroit où elles peuvent avoir un rapport de force avec les laboratoires. En 1994, quand Cleews Vellay [deuxième président de l’association, NdlR] est mort, certains ont voulu dissoudre Act Up. Mais ça aurait été faire peu de cas de toutes les autres personnes séropositives qui faisaient partie de l’association. Ce n’est pas parce que quelqu’un meurt, aussi emblématique soit-il, qu’on doit fermer les portes.
C’est vrai qu’aujourd’hui il y a des combats portés par Act Up (par exemple l’ouverture du don du sang aux homosexuels) qui m’intéressent moins qu’auparavant. Mais ça ne m’empêche pas de respirer politiquement pour autant. Peut-être aussi que les enjeux se sont déplacés ? On meurt moins du sida aujourd’hui qu’avant, les thématiques trans ont pris leur essor et gagné en visibilité… Est-ce que la radicalité politique, aujourd’hui, se trouve encore dans les mouvements gays ? Je ne le pense pas. Je la vois plutôt du côté de la pensée décoloniale, dans les associations d’accueil des migrants, etc.
Pensez-vous justement que le contexte soit favorable à la réémergence d’un mouvement politique minoritaire et radical comme celui que vous dépeignez dans 120 battements par minute ?
Robin Campillo : Je n’ai pas de leçon à donner et je ne sais pas ce qu’il va se passer dans les prochaines années mais oui, je pense que les conditions d’un renouveau politique sont réunies. Aux États-Unis, par exemple, la politique de Trump a ravivé Act Up, notamment parce que sa réforme de l’assurance-maladie va avoir des conséquences désastreuses pour les personnes vivant avec le VIH. Et on voit une convergence avec d’autres minorités, raciales notamment, qui sont elles aussi visées par l’administration républicaine.
Mais j’ai quand même l’impression qu’avec Internet, il est plus difficile de se réunir qu’auparavant. À l’époque où se déroule l’action de 120 battements par minute, quand on avait des désaccords au sein d’Act Up, on venait aux réunions. On s’engueulait, bien sûr, mais le fait de pouvoir se parler directement levait quand même beaucoup de malentendus. Aujourd’hui, ces débats ont lieu sur les réseaux sociaux, via des posts interminables qui ne résolvent jamais rien politiquement…
120 battements par minute de Robin Campillo, avec Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel…
Diffusion le 30 novembre 2020 à 21h sur France 3, suivie du débat “30 ans de lutte contre le VIH”, avec entre autres Didier Lestrade co-fondateur d’Act Up Paris et Françoise Barré-Sinoussi, virologue spécialiste du VIH et présidente de Sidaction.
.
Photos © Céline Nieszawer
3 commentaires
-
Pingback: Aloïse Sauvage en tournée - Hétéroclite
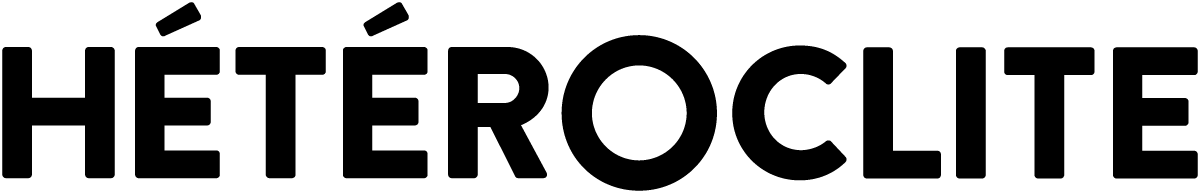
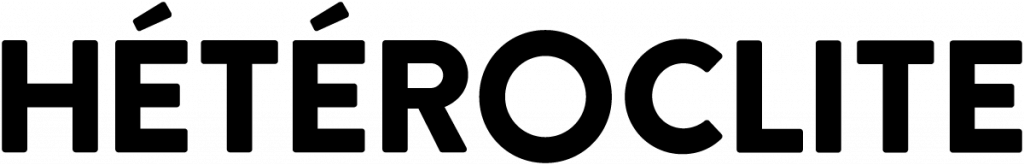



Pingback: Jeanne Balibar et Mathieu Amalric invoquent le fantôme de Barbara