
Jeffrey Weeks à Lyon pour présenter “Écrire l’histoire des sexualités”
Historien et sociologue britannique, militant du Gay Liberation Front dans les années 70, Jeffrey Weeks est un des penseurs incontournables des théories modernes sur les sexualités. Il sera à Lyon pour présenter la publication en français de son livre Écrire l’histoire des sexualités (PUL).
Tous vos travaux sont traversés par l’idée que la sexualité humaine est socialement construite. Qu’entendez-vous par là ?
Jeffrey Weeks : Lorsque je dis cela, cela ne signifie pas que tous nos sentiments et tous nos désirs sont déterminés par la société. Certains le sont, d’autres non. Les questions qu’il faut se poser, c’est plutôt comment est-ce que nous les voyons, quelles valeurs nous y associons, comment nous les conceptualisons, quelle idée nous nous faisons de notre identité sexuelle, des concepts sexuels et de la sexualité en général. C’est cela qui est socialement construit ; c’est le résultat d’influences sociales changeantes, de circonstances historiques, d’idées en perpétuelle évolution sur ce qui est désirable et ce qui ne l’est pas.
Quelle est la différence entre une histoire des sexualités et une histoire des minorités sexuelles ?
La première est plus vaste que la seconde, parce qu’elle englobe également l’histoire des sexualités (et des normes sexuelles) dominantes. Dans mes travaux, j’ai toujours essayé de souligner qu’on ne peut pas comprendre l’homosexualité sans comprendre l’hétérosexualité. Ces deux concepts sont étroitement liés et n’ont de sens que l’un par rapport à l’autre ; ils sont nés dans le même contexte socio-historique, celui du XIXe siècle. Ils résultent de l’idée qu’on ne peut appréhender la sexualité que de façon binaire : l’hétérosexualité et l’homosexualité, ce qui est normal et ce qui est anormal, ce qui est sain et ce qui est déviant, etc. Sans homosexualité, pas d’hétérosexualité, et vice-versa.
 Lorsqu’on écrit sur la sexualité, qu’est-ce que cela change de pratiquer soi-même une sexualité minoritaire ?
Lorsqu’on écrit sur la sexualité, qu’est-ce que cela change de pratiquer soi-même une sexualité minoritaire ?
J’aime penser qu’écrire depuis la position de “l’autre” vous donne une bonne connaissance des formes dominantes de sexualité et de leurs organisations traditionnelles, telles que le mariage, la parentalité… On comprend mieux tout cela quand on en est exclu·e, parce qu’on en a une vue de l’extérieur. Le problème des hétérosexuel·les qui écrivent sur la sexualité, c’est qu’ils et elles ont tendance à considérer l’hétérosexualité comme la seule forme normale et acceptable de sexualité et donc à ne pas s’intéresser à ses autres formes. Ils pensent qu’il existe une séparation infranchissable entre hétérosexualité et homosexualité, alors qu’on sait toutes et tous que des hommes et des femmes hétérosexuel·les ont des relations sexuelles avec des personnes de leur sexe, tout comme beaucoup de gays et de lesbiennes ont des relations avec des personnes du sexe opposé.
« Sans homosexualité, pas d’hétérosexualité, et vice-versa. »
La France aime souvent se présenter comme le pays de la liberté sexuelle et amoureuse. Pourquoi donc a-t-il fallu attendre 2014 pour pouvoir lire un de vos ouvrages en français (Sexualités, déjà publié aux PUL) ? Vos travaux sur la sexualité n’intéressaient-il pas la France ?
La France a en effet, depuis longtemps, la réputation d’un pays ouvert à la sexualité, où on peut discuter de ce sujet librement. Mais elle manifeste assez peu d’intérêt pour la sexualité au sens moderne du terme, c’est-à-dire la sexualité en tant qu’identité, celle qui m’intéresse. C’est sans doute lié à la forte résistance que l’idée d’identités multiples rencontre en France et qui est un frein, par exemple, à l’affirmation d’une identité homosexuelle ouverte et assumée. Dans votre pays, tout est subordonné à une identité unique, l’identité française. Et puis il y a aussi des explications historiques. Pendant longtemps, au Royaume-Uni, la préoccupation principale des dirigeants était l’augmentation trop rapide de la population, alors qu’en France, c’était son augmentation trop lente. D’où des intérêts différents qui sont nés à cette époque autour de la question de la sexualité et qui persistent jusqu’à aujourd’hui.
On assiste aujourd’hui à un retour en force de théories (comme la psychologie évolutionniste, par exemple) qui tentent d’expliquer les comportements amoureux ou sexuels par la biologie ou la sélection naturelle. Cela vous semble-t-il représenter une menace pour la compréhension de l’histoire des sexualités ?
Le problème avec ces théories, c’est que dans le fond, elles sont réductrices et essentialistes. Elles prétendent qu’on peut expliquer n’importe quelle forme de sexualité par des facteurs biologiques : l’ADN, les hormones, l’héritage génétique… Mais il me semble que la façon dont nous vivons notre sexualité et notre genre est bien plus compliquée que cela. Et il me paraît plus intéressant de regarder ce qui a changé au cours de l’Histoire, par exemple pourquoi nos perceptions des hommes et des femmes, des hétérosexuel·les et des homosexuel·les, ont évolué. Ce qui m’inquiète avec des disciplines comme l’évo-psy, c’est qu’elles tentent toujours d’apporter des réponses simples et immédiates à des phénomènes sociaux extraordinairement complexes et intéressants. Je pense que tenter de tout expliquer par la biologie, c’est passer à côté de tout ce qui nous rend humain·es. Nous sommes bien plus que nos gènes ou notre ADN ; nous sommes des créatures sociales. Par conséquent, pour comprendre les sexualités humaines, il faut toujours prendre en compte le hasard, les contingences, mais également la volonté des gens, les décisions qu’ils prennent, la façon dont ils entendent mener leur vie. Un exemple : beaucoup de personnes ressentent des désirs homosexuels. Mais toutes ne l’expriment pas. Et on ne peut comprendre cela que grâce au contexte socio-historique, qui fait que les gens construisent ou non une identité à partir de leur sexualité.
« Je crois que la nostalgie est toujours dangereuse, parce qu’elle s’attache à un âge d’or, quand tout allait supposément mieux, et cela évite de s’intéresser aux changements présents. »
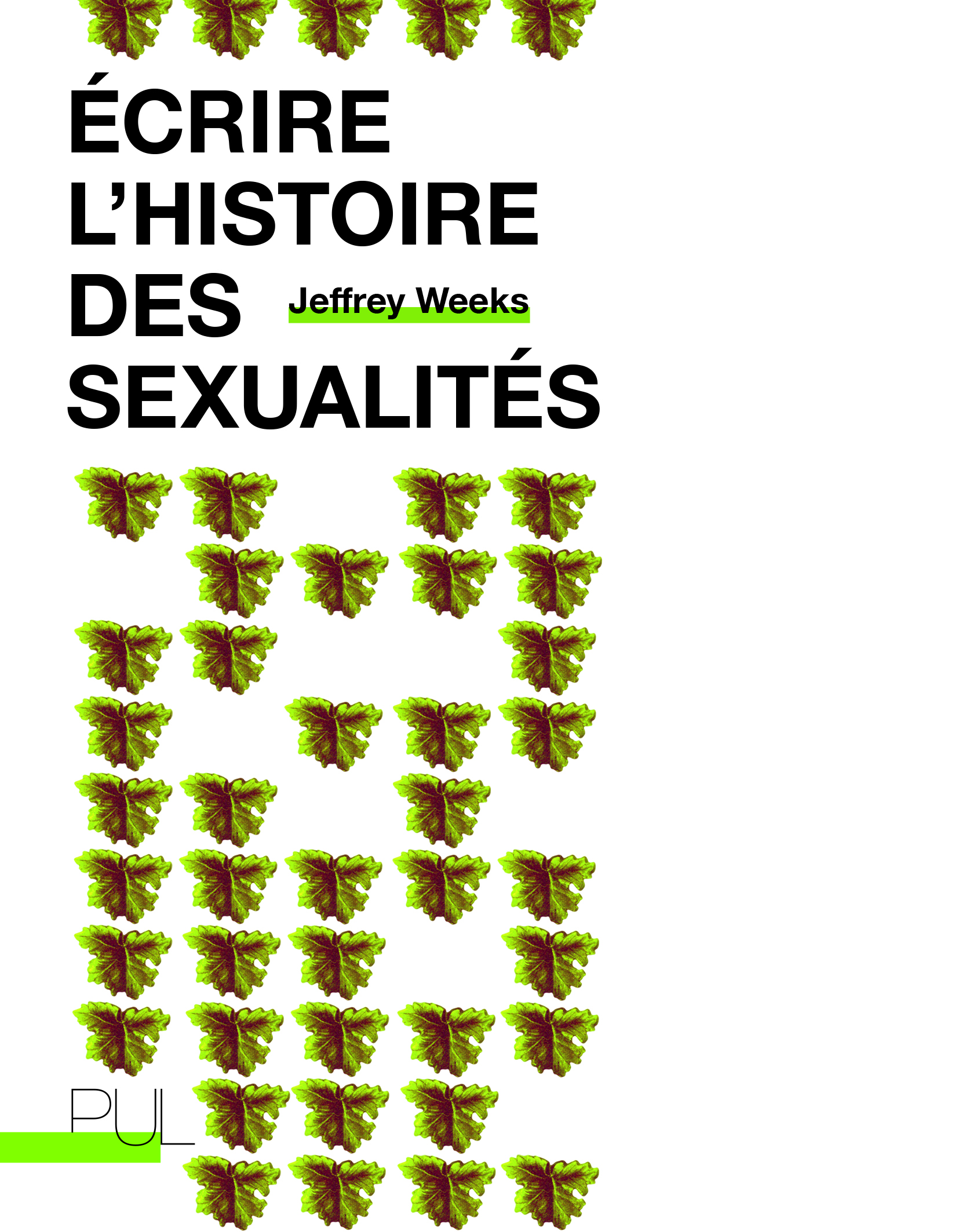 Lorsque vous avez fondé le journal marxiste Gay Left (1975-1980), il semblait aller de soi que l’engagement pour la cause homosexuelle ne pouvait être que de gauche et révolutionnaire. C’est beaucoup moins évident aujourd’hui… Partagez-vous l’analyse selon laquelle « les gays sont passés à droite » ?
Lorsque vous avez fondé le journal marxiste Gay Left (1975-1980), il semblait aller de soi que l’engagement pour la cause homosexuelle ne pouvait être que de gauche et révolutionnaire. C’est beaucoup moins évident aujourd’hui… Partagez-vous l’analyse selon laquelle « les gays sont passés à droite » ?
Non, parce que même dans les années 70, quand les gays ne formaient qu’une toute petite minorité, tous ne se définissaient pas comme révolutionnaires. Il y avait parmi nous des conservateurs, des catholiques, des libéraux, des socialistes, des marxistes… Et la vaste majorité des personnes qui aimaient les individus du même sexe que le leur, qu’elles soient hommes ou femmes, étaient apolitiques, ne voulaient pas se mêler de politique, ou étaient même plutôt conservatrices. Donc, en ce sens, je crois que rien n’a changé. Mais à l’époque, les activistes étaient très peu nombreu·ses. Aujourd’hui, des centaines de milliers de personnes à travers le monde militent pour les droits sexuels et la plupart d’entre elles ne sont pas des libertaires ou des révolutionnaires : elles veulent simplement vivre leur vie tranquillement. Elles ne s’engagent que lorsqu’elles se sentent menacées, que lorsqu’elles identifient une cause pour laquelle elles sont prêtes à se battre. Cela ne me surprend pas. Il y a une sorte de nostalgie pour les premières années du mouvement homosexuel moderne, qui repose en partie sur l’idée fausse que les gays et les lesbiennes d’alors étaient toutes et tous des révolutionnaires. Mais il y a plus de militant·es LGBT aujourd’hui qu’il n’y en a jamais eu dans les années 70. La nostalgie pour cette époque me paraît donc un peu erronée.
Et dangereuse ?
Oui, je crois que la nostalgie est toujours dangereuse, parce qu’elle s’attache à un âge d’or, quand tout allait supposément mieux, et cela évite de s’intéresser aux changements présents, aux luttes actuelles, à ce qu’il faudrait faire ici et maintenant.
En France, on évoque depuis plusieurs années la création d’un grand Centre d’archives LGBT mais la question de savoir si celui-ci devrait être autogéré par des militant·es issu·es de la communauté ou placé sous la tutelle des pouvoirs publics n’est pas tranchée. Quelle est votre opinion sur ce sujet ?
Je pense que si on arrive à convaincre des institutions publiques de se préoccuper des archives, c’est mieux que ce soit elles qui s’en chargent, parce qu’elles ont l’argent, les fonds déjà existants, les ressources humaines et logistiques nécessaires. Mais l’initiative doit toujours venir de la base, de la communauté LGBT. Par exemple, le principal fonds d’archives LGBT du Royaume-Uni, les archives Hall-Carpenter, est abrité par la London School of Economics (LSE). Mais il a été initié par des militant·es et se trouvait à l’origine au sein du London Lesbian and Gay Center. Lorsque ce centre communautaire a fermé, les archives se sont retrouvées en danger et c’est seulement à ce moment-là que la LSE s’y est intéressée. Le danger d’archives gérées uniquement par la communauté LGBT, c’est qu’elles dépendent toujours de l’investissement de bénévoles.
À lire
Écrire l’histoire des sexualités, de Jeffrey Weeks (Presses Universitaires de Lyon)
Rencontre
Avec Jeffrey Weeks, mercredi 3 avril à 20h au Centre LGBTI de Lyon, 19 rue des Capucins-Lyon 1
Événement Facebook
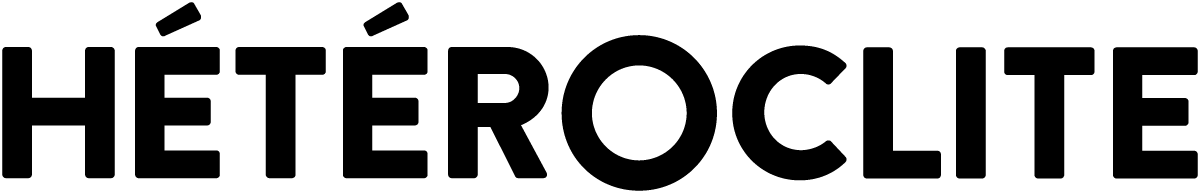
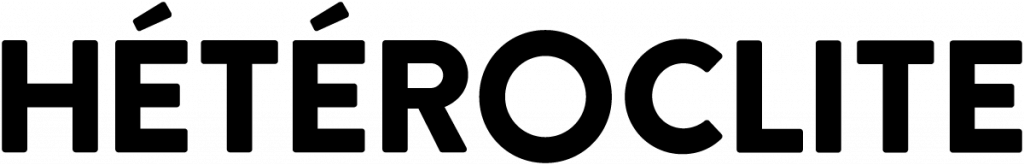



Poster un commentaire