Irresponsables, donc coupables ?
 Transmettre le sida à ses partenaires sexuels peut être dans certains cas considéré comme un délit, voire comme un crime. Une responsabilisation qui apparaît à certains comme juste et nécessaire, mais que d’autres jugent pernicieuse.
Transmettre le sida à ses partenaires sexuels peut être dans certains cas considéré comme un délit, voire comme un crime. Une responsabilisation qui apparaît à certains comme juste et nécessaire, mais que d’autres jugent pernicieuse.
Il y a peu de temps encore, Nadja Benaissa était une star dans son pays, l’Allemagne. Depuis une dizaine d’années, cette jeune chanteuse de vingt-huit ans triomphait au sein du groupe féminin No Angels, qui avait même représenté nos voisins d’outre-Rhin au concours 2008 de l’Eurovision. Mais la roche Tarpéienne est proche du Capitole et si Benaissa fait aujourd’hui les gros titres des journaux, ce n’est pas pour ses performances vocales ou ses ventes d’album. Le 26 août dernier, elle a été condamnée à deux ans de prison avec sursis et trois cents heures de travaux d’intérêt général pour avoir contaminé un de ses partenaires sexuels avec le VIH à la suite d’un rapport non-protégé. Une situation hélas banale. Mais ce qui a motivé la sévérité des juges, c’est qu’elle connaissait alors son propre statut sérologique et ne pouvait donc ignorer les risques qu’elle faisait courir à ses partenaires (elle a en effet reconnu des rapports non-protégés avec trois hommes depuis la découverte de sa séropositivité, mais un seul a été contaminé). Les cas de condamnation pour transmission du VIH restent rares si on les rapporte au nombre de personnes infectées dans le monde (33 millions), mais pas exceptionnels : en France, un homme de trente-deux ans a pour sa part été condamné à de la prison ferme (six mois) et à une indemnité provisionnelle de 15 000 euros pour avoir transmis le sida à son ex-compagne. Bien qu’il ait été informé de sa propre séropositivité, c’est lui qui avait demandé à sa partenaire de renoncer au préservatif… Et les procès de ce type, déjà courants à l’étranger et en particulier dans les pays anglo-saxons, semblent appelés dans les prochaines années à se multiplier : dans le Gard, une jeune femme de vingt et un ans vient à son tour de porter plainte contre son ancien petit ami qu’elle accuse de lui avoir transmis le VIH.
Une justice contre-productive ?
Il est rarissime que les personnes séropositives qui cachent leur statut sérologique à leurs partenaires sexuels et entretiennent avec eux des rapports non-protégés le fassent par intention de nuire ; le plus souvent, il s’agit plutôt de leur part d’une forme de déni qui se traduit par une négligence criminelle, dont les conséquences peuvent être dramatiques. Si, pour les malades qui traînent leurs ex-partenaires devant les tribunaux, cette initiative s’inscrit dans un processus légitime de demande de réparation face au préjudice subi, certains acteurs de la santé publique et associations de lutte contre le sida (voir entretien en page 5) doutent de la pertinence d’une telle démarche. Selon eux, justice et politique sanitaire s’accordent ici difficilement. On ignore en effet quel peut être l’impact de telles décisions judiciaires sur la santé publique : sera-t-il bénéfique, en incitant les séropositifs à renoncer aux pratiques à risques, ou négatif, en dissuadant les personnes qui ignorent leur statut sérologique de se faire dépister ? Edwin Cameron est de ceux qui penchent clairement en faveur de la seconde hypothèse. Ce juge à la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud, lui-même séropositif, est sans doute, au niveau international, la figure de proue des opposants à la criminalisation de la transmission du VIH. Et il se pourrait que ses arguments aient récemment été entendus au plus haut niveau. En juillet dernier, l’administration Obama a en effet adopté une nouvelle approche dans sa politique de lutte contre le sida aux États-Unis : elle estime désormais que les diverses lois criminalisant ou pénalisant la transmission du VIH (adoptées par une trentaine d’États sur le territoire américain) «peuvent aller à l’encontre des objectifs de santé publique de dépistage et de traitement» de la maladie.
Le dépistage, de gré ou de force ?
Le 10 septembre, les sénateurs ont adopté en première lecture le projet de Loi d’Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure (LOPPSI) présenté par le ministre de l’Intérieur Brice Hortefeux. Comme à chaque examen par l’une des deux chambres du Parlement, ce fut l’occasion d’ajouter ou de supprimer des amendements, à l’initiative tantôt des parlementaires, tantôt du gouvernement. Le projet de loi comporte donc désormais un article 37 octies qui inquiète fortement les associations de lutte contre le sida et de défense des séropositifs. Celui-ci dispose en effet que quiconque «ayant commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique […] des actes susceptibles d’entraîner sa contamination par une maladie virale grave» pourra être soumis «à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n’est pas atteinte d’une telle maladie». Y compris sans son consentement. Or celui-ci est requis par l’article 36 du Code de la déontologie médicale (repris par le Code de Santé publique) pour tout acte médical, y compris le dépistage. «Seuls les crimes d’une extrême gravité, comme le viol, peuvent justifier le recours au dépistage coercitif», estime l’association AIDES dans un communiqué. Il est vrai que la formulation employée dans l’amendement gouvernemental est assez floue et ne précise pas quels sont « [l]es actes susceptibles d’entraîner [une] contamination par une maladie virale grave» dans le cadre d’une intervention des forces de l’ordre, ce qui peut laisser craindre une interprétation abusive du texte. À Unité SGP Police Force Ouvrière, syndicat arrivé en tête des dernières élections professionnelles dans la police nationale (2010), on affirme ne pas être au courant de cet amendement gouvernemental. Mais on estime quand même «rassurant» pour les forces de police de connaître le statut sérologique des personnes avec qui elles sont en contact et qui peuvent, le cas échéant, leur transmettre le VIH. Surtout «compte tenu que dans certaines zones (la Seine-Saint-Denis, certains départements de la région parisienne…) nous sommes régulièrement confrontés par exemple à des toxicomanes» (qui font partie des populations “à risques”). C’est d’ailleurs pour cela que les forces de l’ordre, tout comme les personnels soignants, peuvent déjà se voir administrer un Traitement Post-Exposition (TPE) après une situation à risque. Le syndicat rappelle également que, même si les agressions n’ont heureusement que rarement la gravité d’un viol, «un cas de violence, quel qu’il soit, est un cas exceptionnel». Pour éviter tout dérapage, «il faut que le dépistage rentre dans un cadre procédural et qu’il soit suivi par un magistrat». Les représentants des policiers déplorent toutefois, en accord avec les associations, «une parfaite méconnaissance» des problématiques liées à la séropositivité et même «une stigmatisation» des porteurs du VIH. La faute à «la disparition de la formation continue des policiers, par manque de moyens. L’information n’existe tout simplement pas», regrette le syndicat.
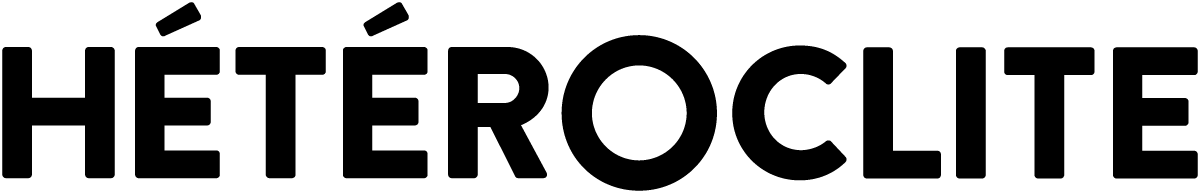
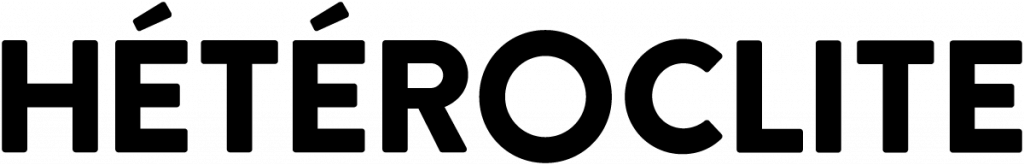



Poster un commentaire