
Les Cinq Diables : rencontre avec la réalisatrice Léa Mysius
“Comme beaucoup de gens, ça m’excite les histoires de sorcières”
Hétéroclite : Pourriez-vous nous présenter votre film, Les Cinq Diables ?
Léa Mysius : Vicky est une petite fille un peu burlesque, étrange, à la fois drôle et inquiétante, qui a un don pour les odeurs. Elle sait les reconnaître et collectionne notamment celle de sa mère, Joanne, qu’elle adore plus que tout au monde. Cette petite fille porte le poids d’un passé qu’elle ne connaît pas, et quand la sœur de son père, Julia, fait irruption dans sa vie, son don va se transformer en quelque chose de magique, qui lui permettra d’être transportée dans le passé de ses parents, et de comprendre les secrets de son village, sa famille et sa propre existence.
Le titre, Les Cinq Diables, se réfère aux cinq personnages principaux, mais c’est aussi le nom d’un lieu et d’un lac du village où habitent les personnages.
Dans ce récit, la magie est détenue par les femmes, il y a une certaine ambiance de sorcellerie.
Comme beaucoup de gens, ça m’excite les histoires de sorcières. La puissance des femmes, leur côté agissant et inquiétant. Je viens du Médoc, une région française où il y a beaucoup de magiciens. J’ai essayé de parler d’une magie universelle, pas culturelle. Je ne voulais pas choisir de rite existant, c’est pour ça que j’ai pensé à une magie basée sur les odeurs.
Pouvez-vous nous parler de l’histoire d’amour centrale du film, qui s’éloigne des codes de représentation lesbienne habituels ?
Le film est aussi à propos de Joanne, qui redécouvre un amour de jeunesse qu’elle a laissé partir pour un drame qu’on comprend à la fin. Il s’agit aussi de voir l’histoire d’amour de cette femme à travers les yeux de sa fille, qui adore sa mère et voit que quelqu’un, peut-être, va lui “voler”.
Je n’ai pas du tout pensé le film avec une histoire lesbienne, je me suis simplement dit : “J’écris une histoire d’amour”, et il se trouve que c’était entre deux femmes. Peut-être que du coup, j’ai évité les codes des films lesbiens. Après, évidemment, la question de l’homosexualité est planante dans le film, dans le sens où Joanne a choisi une vie beaucoup plus conformiste avec un mari, un enfant, un pavillon, et peut-être que son amour de jeunesse est moins conforme, à ce qu’attend son père par exemple. Dans ce village où elle habite, il y a une homophobie latente, mais on n’en parle jamais frontalement. Comme le racisme, je voulais que ce soit quelque chose qui plane, pour dénoncer que ça existe, mais nos personnages vivent cette histoire d’amour sans entrave.
“En tant que cinéastes, on change les systèmes de représentation”
Vous livrez une représentation intéressante du racisme et de l’homophobie ordinaires.
J’ai l’impression que si on représente le racisme et l’homophobie tels qu’ils sont, les gens ont tendance à dire “non mais c’est pas à ce point là quand même”, et du coup ce n’est pas utile dans le sens où le spectateur se sent en dehors. Alors que si c’est beaucoup plus insidieux… Dans le film, ce n’est pas frontal, il y a peu de choses, c’est des petites réflexions, une ambiance. C’est comme si un poison se répandait, et l’idée est que le spectateur juge lui-même, en se disant “Non mais attend ce n’est pas normal, ce sont des gros racistes et homophobes en fait”. Et que chacun conclut qu’il faut réagir, pas rester passif. Parce que j’ai l’impression que dans la haine des différences, le plus grand danger est cette passivité.
Lors de votre présentation du film, vous avez parlé de systèmes de représentation.
En tant que cinéastes, on change les systèmes de représentation. On a une responsabilité là-dessus. Quand j’écris une histoire, je me dis que ce n’est pas un problème d’aimer une femme, ni d’être noire dans un petit village français. Ça pour moi, c’est proposer de nouveaux systèmes de représentation. À la fois, je ne veux pas non plus dire : “Il n’y a pas de problème en France aujourd’hui, à être métisse ou noire dans ce contexte, ou à aimer une femme”. Donc c’est toujours l’équilibre entre les deux. J’aimerais que les gens sortent de la salle en se disant “Ben non, ce n’est pas un problème, et c’est quoi cette ambiance ?”
Comment trouver cet équilibre ?
J’essaye de ne pas aller vers l’utopie, mais de faire quelque chose de possible. Je pourrais faire un film où ce ne serait absolument pas un problème. Mais vu que je veux parler de la société actuelle, et que ça l’est encore, il faut le combattre. On est quand même un pays où le deuxième parti est l’extrême droite, donc on va pas se mentir là-dessus.
À VOIR
Les Cinq Diables de Léa Mysius, avec Adèle Exarchopoulos, Sally Dramé, Swala Emati, Moustapha Mbengue…
En salles le 31 août 2022.
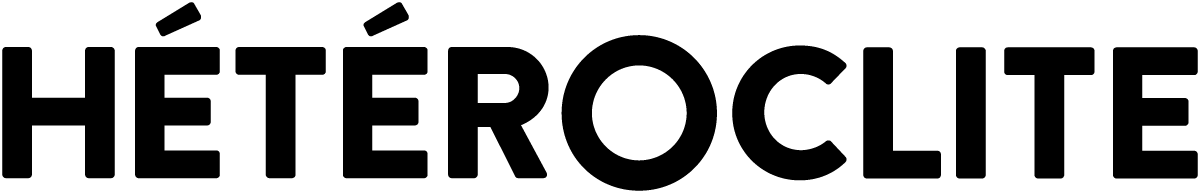
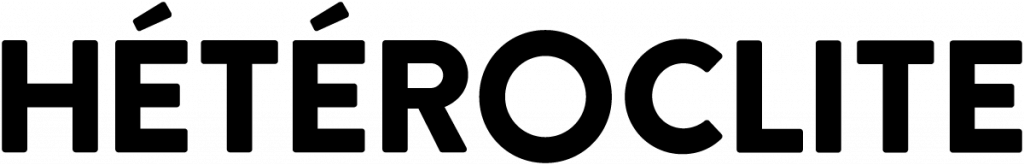



Poster un commentaire