
Dorian Cessa propose un questionnaire sur le chemsex
Dorian Cessa, interne en 3e année de psychiatrie à l’AP-HM, étudiant en 2e année de sexologie, et par ailleurs chargé des questions de santé chez Plusbellelanuit, effectue actuellement un stage aux Hospices Civils de Lyon avec les équipe du Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) de la Croix-Rousse. Dans le cadre de ses recherches de thèse, il propose un questionnaire en ligne, Sea, Sex and Chems autour du chemsex ouvert à celles et ceux qui le pratiquent et bien au-delà.
Hétéroclite : Comment définiriez-vous le chemsex ?
Dorian Cessa : Le chemsex est une pratique qui mélange la question de la sexualité et celle de la consommation de substances psychoactives. Historiquement, il s’agit principalement de méthamphétamine lorsque la pratique commence à se développer en France dans les milieux parisiens, mais le chemsex prend surtout son essor avec l’arrivée des Nouveaux Produits de Synthèse (NPS), des cathinones de synthèse dont la plus connue est la 3-MMC.
Ce qui caractérise principalement la pratique du chemsex, c’est la consommation de produits psychoactifs et donc souvent de drogues, à visée sexuelle. C’est l’objectif de la consommation de drogues, ce qui diffère de la consommation de drogues dans un milieu festif, par exemple, qui pourrait déboucher ensuite sur de la sexualité.
Et même si on parle beaucoup de la 3-MMC et des cathinones, on peut aussi citer la cocaïne, la kétamine , le GHB et le GBL qui participent au phénomène du chemsex.
Du coup, peut-on dire que la pratique du chemsex recouvre des réalités diverses ?
Je pense que globalement oui, il y a des réalités très diverses non seulement par les produits qui sont consommés mais aussi par le contexte. Je crois qu’on se représente beaucoup la question du chemsex à travers l’organisation d’orgies et de partouzes, ce qui reste fréquent en effet. Mais c’est loin d’être la seule consommation de chemsex. Il y a pas mal de gens qui peuvent consommer uniquement à deux ou en couple. Et une pratique qui s’est renforcée depuis un an pendant l’épidémie de Covid, ce sont les consommations de chemsex seul, sur des sessions qu’on a appelé « porno-masturbation », c’est-à-dire de la masturbation avec de la pornographie accompagnée de consommation de produits, y compris parfois avec des injections.
Lyon a connu plusieurs morts suite à des pratiques chemsex en 2018, qui ont suscité une certaine agitation médiatique, mais cela semble être retombé. Cela signifie-t-il que les pratiques sont plus maîtrisées ? Qu’il y a moins de pratiques ? Ou simplement que la presse mainstream s’en est désintéressée ?
Concernant Lyon, je n’ai pas eu d’échos qu’il y ait eu d’autres décès directement imputables au chemsex. Alors certes, il y a eu un effet de presse en 2018 suite à plusieurs morts qui a coïncidé avec une découverte du phénomène par le grand public.
Probablement, et c’est ce que soulignait un rapport sur la consommation de drogues en 2019, la succession de décès qui a eu lieu en 2018 à Lyon a conscientisé ou en tout cas appelé les usagers à une certaine vigilance, notamment par rapport au GHB et au GBL qui comportent des risques importants s’ils sont consommés avec de l’alcool.
Néanmoins, on voit que le GHB est en train de revenir dans les milieux communautaires. Le chemsex est en train de se banaliser dans la communauté gay et surement au-delà. J’espère que les gens font un peu plus attention mais on n’a pas l’impression qu’il y a une décroissance des consommations. Ce que l’on peut voir par ailleurs dans les milieux de soins, qui n’est pas forcément représentatif de l’ensemble du chemsex, c’est que l’épidémie de Covid a très peu modifié les pratiques et la quantité de consommation. On serait d’ailleurs plutôt sur une augmentation des consommations, comme cela est constaté pour l’ensemble des addictions en temps de Covid.
Ce qui souligne qu’au-delà de la question de sexualité, le chemsex, malgré ses spécificités, est assez proche des autres problématiques d’addictologie.
On associe le chemsex à la communauté gay. Mais est-ce qu’à votre connaissance le chemsex touche d’autres communautés ou est-ce qu’au contraire il y a un profil très particulier de chemsexeurs ?
Par rapport aux chemsexeurs que l’on rencontrait en milieu de soins, principalement dans des villes comme Lyon ou Paris il y a encore 5 ans, on avait un profil assez typique d’hommes plutôt âgés de 35-45 ans, souvent CSP+.
Ces derniers temps, on voit arriver des profils un peu différents, plus jeunes, issues de catégories socio-professionnelles plus variées qu’à l’époque.
Néanmoins, c’est compliqué de savoir si le phénomène se diffuse dans d’autres communautés. C’est d’ailleurs un des buts de notre étude actuelle. Dans les autres communautés, on n’utilise pas le terme de chemsex. Or le chemsex n’a pas inventé la consommation de drogues dans le cadre de la sexualité. Et le phénomène a rapidement été assimilé à l’organisation d’orgies. Mais je pense que la problématique est plus complexe et que oui, la pratique est en train de se diffuser dans d’autres communautés. J’aimerais notamment pouvoir interroger des lesbiennes sur cette question.
On voit aussi la pratique se développer dans les milieux hétéros notamment libertins. Ce qui est sûr en revanche c’est que les cathinones de synthèse commencent à arriver dans les milieux hétéros, principalement dans un contexte festif pour l’instant en remplacement de la cocaïne et de la MDMA, notamment parce qu’un gramme de 3-MMC est 2 à 3 fois moins cher qu’un gramme de coke.
Par extension, j’aurais donc tendance à croire que la pratique est en train de se développer dans d’autres communautés. Mais cela reste difficile à évaluer parce que les hétéros ne se considèrent pas comme chemsexeurs.
Dans le cadre de vos recherches, vous proposez donc un questionnaire sur le chemsex. Pourquoi vous êtes-vous intéressé, en tant qu’étudiant en médecine, à cette pratique ?
J’avais couvert pour Le Monde en 2017 le premier colloque sur la santé des personnes LGBT+ organisé au Ministère de la Santé dans le cadre des Gay Games 2018. Et j’avais rencontré le médecin généraliste Thibaut Jedrzejewski, qui était un des premiers à faire une thèse de médecine générale sur les populations gays, en sortant du spectre du VIH.
Et ça rejoignait une de mes réflexions selon laquelle la médecine a du mal à prendre en compte les aspects sociologiques de certaines populations, et pas seulement des populations LGBT+ d’ailleurs. C’est le cas notamment concernant les personnes migrantes. Je pense qu’il y a des habitudes de vie et des contextes sociologiques qui ne peuvent pas être déconnectés de la pratique de la médecine et on a un peu de mal en France à lier les deux.
Ça a quand même été fait, notamment pour le VIH, non ?
Oui mais uniquement sur la problématique du VIH. Mais par exemple, sur le risque dépressif et suicidaire chez les jeunes homos, dont on sait qu’il est 5 fois supérieur à celui de la population générale, il n’y a pas énormément d’études.
Tout ça pour dire que j’ai eu envie de travailler sur un sujet qui pouvait être utile à la communauté LGBT+. Concernant le chemsex, je trouve que c’est un phénomène qui se développe et qui est inquiétant. Dans le milieu de soins, on voit des gens, principalement des mecs pour être honnête, qui sont dans une souffrance liée à leur consommation tout en étant incapable de l’arrêter vraiment.
Et puis, je trouve que c’est médicalement un sujet intéressant, qui pose la question de la co-addiction. La co-addiction, c’est le fait d’avoir deux addictions en même temps, avec un effet cumulatif, une addiction entretenant l’autre. Il y a donc la question aux substances mais également la question de l’addiction sexuelle, comportementale. Et quels liens ces deux types d’addiction entretiennent entre elles.
Le questionnaire Sea, Sex and Chems que vous proposez doit-il vous permettre de dresser une cartographie de la situation actuelle du chemsex ?
Une cartographie, ce serait prétentieux. L’idée, c’est de repérer principalement ce qu’au niveau médical on appelle les facteurs de risques. On cherche les éléments déclencheurs de l’addiction dans une population, afin de travailler sur la réduction des risques et des dommages. Par pour diaboliser la pratique mais pour se rendre compte, en tant que médecin, à quel moment ça devient inquiétant et à risque d’addiction afin de proposer une prise en charge. Il s’agit d’empêcher les souffrances à venir, induites par le comportement addictif.
Le questionnaire se penche à la fois sur la questions de l’addiction aux substances que sur celle de l’addiction comportementale. Bien que la question de l’addiction sexuelle soit un sujet encore compliqué qui ne fait pas totalement consensus au niveau international.
D’ailleurs, en parcourant votre questionnaire, on rencontre une partie sur les pratiques de consommation, une partie sur les pratiques sexuelles et une partie sur l’estime de soi. Vous pouvez nous expliquer comment s’enchevêtrent ces trois axes ?
La question des consommations de produits est assez évidente, encore que l’intérêt de savoir quels produits sont consommés, c’est de savoir quels effets sont recherchés et quels produits sont plus à risque addictif.
Effectivement, c’est aussi un travail de sexologie, il y a donc une importante partie sur les pratiques sexuelles, parce qu’on se rend compte que dans certaines catégories, par exemple dans la communauté du fist, on trouve beaucoup de consommateurs de produits. Pour s’occuper du chemsex en tant que médecin, il faut avoir une connaissance de la sexualité et la capacité à évoquer ces choses-là.
Ça parait compliquer en effet d’aborder la question du chemsex sans parler de sexualité. Et en vrai, l’évocation de la sexualité dans le milieu médical français reste complexe. Or, il faut être capable d’apporter des solutions aux personnes qui souhaitent sortir du chemsex afin qu’elles conservent une sexualité qui puissent les satisfaire.
Enfin,ce qui ressort des études précédentes sur le chemsex, c’est une proportion importante de dysfonctionnements sexuels chez les gens qui ont recours au chemsex. On peut donc imaginer que la question de l’estime de soi puisse jouer, le produit permettant de se désinhiber.
Le but de ce questionnaire est donc de fournir une grille de lecture de la pratique du chemsex à destination des médecins et du personnel soignant ?
Oui, il s’agit d’offrir une ressource à destination du personnel médical, notamment parce que certaines pratiques sexuelles sont mal connues de la plupart des médecins.
Mais je souhaite aussi pouvoir diffuser les résultats auprès du grand public dans une démarche de prévention.
À qui s’adresse ce questionnaire ?
Aux personnes qui pratiquent le chemsex mais aussi à celles qui ne le pratiquent pas. Mais jusqu’à présent les études autour du chemsex s’intéressent principalement aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Là, l’idée est de chercher aussi ailleurs et de pouvoir comparer, par exemple, les populations gays qui pratiquent le chemsex et les populations gays qui ne le pratiquent pas. Ça permettra aussi peut-être de voir le niveau de circulation des cathinones de synthèse dans le milieu hétéro et de sortir du ressenti et des hypothèses pour avoir des données chiffrées.
Pour répondre au questionnaire Sea, Sex and Chems en ligne : https://seasexandchems.fr/
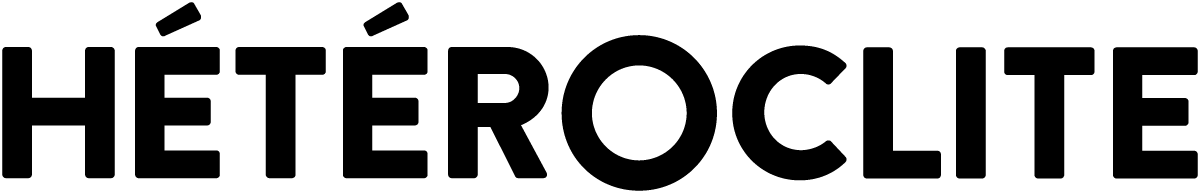

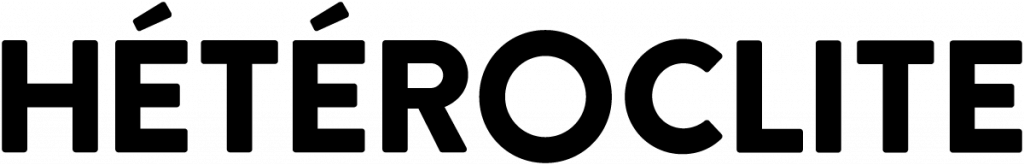



Pingback: Sexe, prod’ et consentement au Centre LGBTI+ de Lyon - Hétéroclite